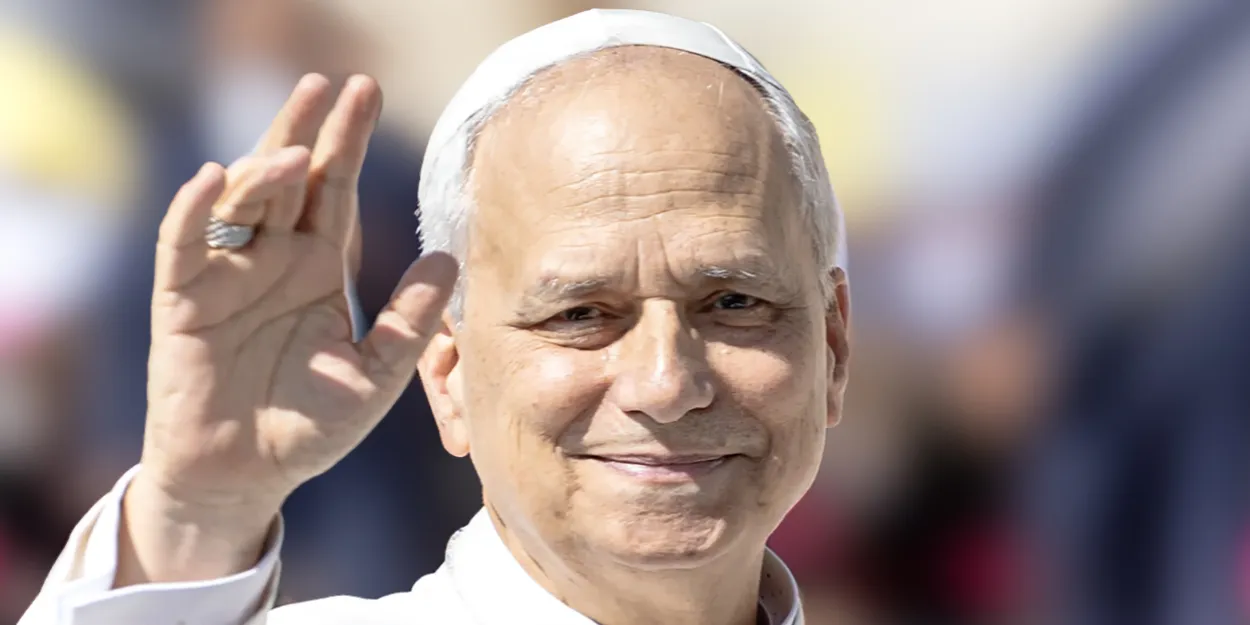Alors que la violence entre leurs pays s’intensifiait, les croyants se sont tournés vers la prière pour espérer la paix.
Jeudi 8 mai, vers 3 heures du matin, une explosion assourdissante a secoué la ville de Gujranwala, au Pakistan, à environ deux heures de route du poste-frontière d’Attari-Wagah.
Alors que la ville semblait secouée de toutes parts, des cris de panique ont résonné dans la maison de Sharaz Sharif Alam. Ses quatre fils et ses parents âgés, profondément bouleversés, s’interrogeaient sur leur sécurité. Depuis deux jours, une panne d’électricité plongeait le pays dans l’obscurité, et un silence oppressant régnait dans les rues désertes.
Réfugiée dans une pièce faiblement éclairée par des lampes à batterie, la famille s’est réunie, main dans la main, pour prier. Alam a alors commencé à appeler les membres de son église pour s’assurer qu’ils allaient bien.
“On ressentait une profonde vulnérabilité, une peur sourde que quelque chose de bien plus grave soit à venir”, confie Alam, secrétaire général de l’Église presbytérienne du Pakistan.
“Nous avons prié — non seulement pour nous-mêmes, mais pour chaque enfant incapable de trouver le sommeil, pour chaque mère serrant ses enfants contre elle, pour chaque famille, musulmane ou chrétienne, qui, sur cette terre blessée, attendait désespérément la lumière du jour.”
Pendant ce temps, à deux heures de route de la même frontière, dans la ville indienne de Pathankot, Shiji Benjamin avait le sentiment de vivre en pleine zone de guerre.
Le gouvernement avait décrété un couvre-feu strict dans la nuit de jeudi à vendredi, ordonné la fermeture des commerces dès la tombée du jour, et plongé toute la ville dans l’obscurité pendant quatre nuits d’affilée — ni éclairage public, ni lumière dans les foyers, rien.
La nuit venue, Shiji Benjamin voyait des éclairs traverser le ciel, suivis de détonations “qui faisaient trembler le cœur”, alors que l’armée indienne interceptait des drones ennemis. Parfois, des débris s’écrasaient non loin de chez elle, prenant feu à l’impact.
“Chaque bruit, chaque fracas faisait bondir nos cœurs”, raconte celle qui est coordinatrice nationale du ministère parmi les femmes de l’Indian Evangelical Team. “On ignorait ce qui allait se passer, ou même si on se réveillerait en vie le lendemain.” Avec sa famille et ses voisins, elle n’a cessé de prier pour la protection de leur ville et le retour de la paix.
Les violents affrontements entre l’Inde et le Pakistan ont éclaté la semaine dernière après que des hommes armés d’un groupe jusqu’ici peu connu, le Resistance Front, ont tué 26 personnes — principalement des touristes indiens — et blessé une douzaine d’autres dans le territoire indien du Jammu-et-Cachemire, le 22 avril.
L’Inde a attribué au Resistance Front des liens avec les groupes terroristes pakistanais Lashkar-e-Taiba et Jaish-e-Mohammed, des accusations que le Pakistan a fermement démenties.
En représailles, l’Inde a lancé “l’Opération Sindoor”, une série de frappes militaires contre des cibles dans la province pakistanaise du Pendjab et au Cachemire sous administration pakistanaise, tuant des dizaines de civils et détruisant des infrastructures associées à des milices pakistanaises. Le Pakistan a riposté par des bombardements, faisant à son tour de nombreuses victimes civiles indiennes.
Des drones ont frappé des habitations et des quartiers de part et d’autre de la frontière, tandis que des avions de chasse sillonnaient le ciel pour intercepter les attaques, dans un contexte de plus en plus meurtrier pour les civils.
Le 10 mai, un cessez-le-feu, négocié par l’entremise des États-Unis, a finalement été accepté par les deux pays — chacun revendiquant la victoire. Plusieurs mesures diplomatiques restent toutefois en vigueur, notamment la suspension d’un traité de partage des eaux, la fermeture de l’espace aérien et de certains postes-frontière.
Le Cachemire, région montagneuse disputée, se trouve au centre du conflit qui oppose l’Inde et le Pakistan depuis des décennies — un différend né de la Partition de 1947, lorsque la Grande-Bretagne a divisé son ancienne colonie entre une Inde à majorité hindoue et un Pakistan à majorité musulmane.
Depuis lors, environ trois millions de personnes ont perdu la vie dans la région — victimes de la violence, de la faim, du suicide ou de la maladie. La Partition a été marquée par des massacres entre communautés, des conversions forcées, des incendies volontaires et des violences sexuelles, notamment dans les provinces du Pendjab et du Bengale.
Le plan britannique n’ayant pas tranché sur le sort du Cachemire, les deux jeunes nations en ont revendiqué la souveraineté, ce qui a rapidement conduit à une guerre ouverte en 1949. Celle-ci s’est conclue par un cessez-le-feu : l’Inde prenant le contrôle des deux tiers du territoire, et le Pakistan, du tiers restant.
Les chrétiens en Inde et au Pakistan ont également vécu une histoire mouvementée liée à la Partition. Avant celle-ci, environ 500 000 chrétiens vivaient dans la région du Pendjab. Au 19e siècle, des missionnaires presbytériens américains y avaient fondé des lycées, des universités et des dispensaires.
Lors de la Partition, les chrétiens se sont retrouvés face à un choix difficile : s’installer à l’ouest, dans une région majoritairement musulmane, ou à l’est, dominée par les hindous et les sikhs. “Le choix de l’une ou l’autre province était assurément très difficile”, écrit l’historien pakistanais Yaqoob Khan Bangash.
Dans le Pakistan nouvellement formé, le gouvernement a arrêté des centaines de chrétiens pour espionnage lors de la guerre de 1965 entre l’Inde et le Pakistan au sujet du Cachemire, ainsi que durant la guerre de 1971 qui a conduit à la création du Bangladesh. Les musulmans les traitaient souvent durement, les reléguant à des emplois subalternes comme balayeurs, postes laissés vacants par les Dalits hindous partis pour l’Inde.
Les chrétiens d’Inde n’ont pas été épargnés. Les violences se sont intensifiées depuis l’arrivée au pouvoir du parti nationaliste hindou BJP en 1998 : assassinats de responsables chrétiens, destruction d’églises et d’écoles, persécutionsreligieuses et conversions forcées à l’hindouisme.
Les tensions entre les deux pays ont régulièrement explosé au Cachemire. Le dernier grand conflit remonte à 2019, lorsqu’un groupe extrémiste pakistanais a tué 40 soldats indiens dans la région contrôlée par l’Inde.
Pourtant, la petite minorité chrétienne de cette région à majorité musulmane a surtout vécu “pacifiquement” avec les autres confessions, écrivait en 2020 l’apologiste indien Jacob Daniel. Après la Partition, l’autrice Angela Misri évoquait par exemple des cousins kashmiris ayant reçu un enseignement de professeurs hindous, musulmans, sikhs et chrétiens.
Mais les chrétiens des deux pays continuent d’être persécutés pour leur foi : le Pakistan arrive en deuxième position et l’Inde en troisième dans l’Index de l’ONG Portes Ouvertes qui recense les pays où les violences contre les chrétiens sont les plus graves.
Les tensions ont aussi affecté les relations entre chrétiens au Cachemire il y a une dizaine d’années, lorsque des missionnaires étrangers y ont converti des musulmans, provoquant l’inquiétude des chrétiens locaux craignant l’attention et d’éventuelles représailles du gouvernement. Le nationalisme hindou grandissant a aussi conduit à des attaques récentes contre des chrétiens.
Ujala Hans, installée à Lahore, au Pakistan, a vécu personnellement les répercussions de la Partition : son grand-oncle réside toujours en Inde. Ses parents, quant à eux, ont aussi traversé les années d’instabilité politique qui ont suivi, alors que l’Inde et le Pakistan se disputaient le contrôle du Cachemire.
Lors des tensions entre fin avril et début mai, sa mère a rappelé avec foi que Dieu les avait protégés pendant la guerre de 1971, et qu’il les garderait encore aujourd’hui. Malgré cela, Ujala Hans — elle-même pasteure — a préféré mettre en garde son père contre tout contact avec leur parent indien, de peur que les autorités pakistanaises ne les accusent d’espionnage.
Malgré les tensions, les relations entre chrétiens indiens et pakistanais ne se sont pas détériorées, affirment ceux que nous avons pu interroger.
Hans a tissé des liens d’amitié avec des pasteurs indiens lors de voyages à l’étranger. “On ne peut pas se rendre dans nos pays respectifs, mais quand on se retrouve ailleurs, on est comme une seule famille”, dit-elle, soulignant que la langue commune, l’ourdou ou l’hindi, facilite souvent le rapprochement entre chrétiens.
“Ce que j’ai vu, c’est que l’Église indienne prie avec ferveur pour l’Église pakistanaise, et qu’elle aime les chrétiens pakistanais”, affirme la pasteure.
Reconnaître leur identité commune en Christ permet aux chrétiens des deux pays de “s’aimer au-delà des frontières”, estime Shiji Benjamin. “Quand le monde voit de l’hostilité, nous pouvons choisir de voir une souffrance partagée, une foi commune et une humanité unie.”
Ce sentiment de solidarité n’est pas le seul fruit inattendu du récent conflit. Celui-ci a aussi rapproché les différentes religions au Pakistan, selon Alam.
Même si des missiles avaient frappé près de Gujranwala et de Muridke, Alam ne pouvait rester enfermé chez lui. Le lendemain de l’explosion, il a participé à une réunion d’urgence avec des pasteurs, des imams et des leaders de la société civile. Ils ont décidé d’organiser une marche interreligieuse pour la paix le 8 mai.
La marche de deux kilomètres a commencé à 13h30, au départ et à l’arrivée de l’église presbytérienne Swift Memorial First. Tout au long du parcours, Alam et les 200 participants ont scandé des slogans comme “Hum aman chahte hain” (“Nous voulons la paix”) et “Pak army zindabad” (“Vive l’armée pakistanaise”).
Alam a marché côte à côte avec des pasteurs et des imams, tandis que des jeunes musulmans et chrétiens portaient de grandes bannières jaunes appelant à la solidarité interreligieuse. Il a partagé des versets bibliques tels que Romains 12.18 (“S’il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous”) et Jérémie 29.7 (“Recherchez la paix et la prospérité de la ville où je vous ai exilés”).
“C’était un aperçu de la communauté bien-aimée, un avant-goût du royaume de Dieu, où les épées deviennent des charrues et les ennemis deviennent des proches”, raconte Alam.
Le lendemain du cessez-le-feu, Alam a coorganisé une autre marche, cette fois pour remercier Dieu d’avoir protégé le Pakistan.
Environ 200 personnes sont sorties de l’église presbytérienne de Ghakkar Mandi pour participer à la marche. La pasteure Romella Robinson, épouse de Sharaz Sharif Alam, a alors élevé une prière :
“Seigneur, que les nations renoncent à la voie de la destruction pour emprunter celle de la réconciliation. Apprends-nous à rechercher la paix et à la poursuivre sans relâche.”
Isabel Ong
Un article de Christianity Today. Traduit avec autorisation. Retrouvez tous les articles en français de Christianity Today.